Eléments de cours sur la théorie de la croissance, illustrée par des textes traduits de Paul Romer.
x
A technologie constante, la croissance rencontre nécessairement deux types de limites. La première tient à l'apparition de goulots d'étranglement. Certains facteurs deviennent limitants : la main d'oeuvre, du fait du plein-emploi ou de la pénurie de certaines catégories de travailleurs; certaines sources d'énergie, certaines matières premières, la terre dans une économie agricole, du fait de leur épuisement. De ce point de vue, la révolution industrielle anglaise est un cas d’école :
L’expansion dans le cadre des techniques traditionnelles se heurte à un certain nombre de goulets d’étranglement. Le plus caractéristique concerne la métallurgie : l’épuisement des ressources forestières entraîne une forte augmentation du prix du charbon de bois, et la hausse du coût de production tend à bloquer la croissance ; seul l’accroissement rapide des importations de fer russe et suédois permet de maintenir l’activité des forges. Plus généralement, l’épuisement relatif des ressources de main-d’oeuvre, au moins dans les régions les plus actives, pénalise de nombreuses branches à travers un accroissement sensible des coûts salariaux (même si les salaires, dans l’absolu, restent très bas). La révolution industrielle peut être considérée comme le résultat d’efforts systématiques pour surmonter ces facteurs de blocage, grâce à un ensemble d’innovations assurant des gains de productivité sans précédent.
x
Jean-Charles Asselain, Histoire économique de la France. Point Histoire
Face aux goulots d'étranglement, il a fallu trouver de nouvelles combinaisons productives, de nouvelles "recettes" :
Une métaphore parlante est celle de la cuisine. Pour préparer un plat, nous combinons divers ingrédients selon quelque recette. Mais en s’en tenant aux seules recettes connues, la quantité que l’on peut cuisiner est limitée par l’offre d’ingrédients. La solution consiste à inventer de nouvelles recettes, qui utilisent de nouveaux ingrédients ou font la part plus belle à ceux disponibles en abondance.
Paul ROMER, Economic Growth, Fortune Encyclopedia of Economics (trad. par moi).
Ainsi, l'économie anglaise s'est adaptée en substituant des ressources abondantes (le coton du nouveau monde, le charbon anglais) à d'autres devenues rares (la laine, le bois...), le capital (la machine à vapeur) au travail...

L'autre limite de la croissance, ce sont les rendements décroissants.
Exemple 1 : le capital technique
Une économie qui accumulerait toujours plus d’unités d’une même espèce de capital fixe butterait sur le problème des rendements décroissants. Ainsi, un chariot élévateur est un engin très utile, et aussi longtemps qu’une entreprise n’est pas bien équipée, investir dans l’achat d’un chariot supplémentaire demeure rentable. Néanmoins, au fur et à mesure que croît le parc de chariots élévateurs, le rendement marginal décroît rapidement. A la limite, un chariot de plus devient complètement inutile. Il suit de là que la croissance économique ne saurait venir de l’accumulation continue des biens d’équipement existants.
Exemple 2 : le capital humain
Si j’ai arrêté mes études au lycée et que j’envoie mon fils à l’université, je suis en droit d’espérer qu’il bénéficiera d’un meilleur niveau de vie que le mien. Mais si chaque famille fait de même, ce type de stratégie vient butter sur le problème des rendements décroissants. Supposons qu’il n’y ait eu aucune innovation technologique depuis le 18ème siècle, nous aurions eu beau scolariser toujours plus d’enfants, toujours plus longtemps, accumulant ainsi du capital humain, nous devrions bien admettre qu'une économie où l'on se déplace encore en charrette à boeufs n’a tout simplement pas besoin d'autant de diplômés !
Paul ROMER, Beyond classical & keynesian policy, Policy options, 1994 (trad. par moi).
Face aux rendements décroissants, il faut un changement de technique pour relancer la croissance :
Un nageur investit dans son temps de piscine un peu comme une économie investit en capital. Il ne peut année après année améliorer indéfiniment ses performances simplement en s’entraînant davantage. Il y a des limites physiques au développement de la puissance musculaire et des capacités d’aérobie. Pourtant, depuis les années 50, le nombre de records du monde battus chaque année est demeuré à peu près le même. Fondamentalement, à l’origine de ces améliorations des performances, on trouve la même source en natation qu’en économie : le perfectionnement des techniques. Ainsi, en 1875, date de la 1ère traversée de la Manche à la nage, la brasse passait pour la meilleure technique du moment ! Mais bientôt des nageurs australiens et anglais découvrirent et développèrent une technique utilisée jusque là par les aborigènes et les habitants de Ceylan : le crawl.
Ibid.
En résumé, nous dit Paul Romer, une croissance durable passe par l'invention et la diffusion de meilleures recettes et de meilleures techniques :
Les progrès du niveau de vie obtenus tout au long de ce siècle furent possibles uniquement parce que des découvertes et innovations ont permis à du nouveau capital fixe et à du nouveau capital humain d’être alloués à de nouvelles activités hautement profitables.
Paul ROMER, Economic Growth, op. cit.
Las ! Le progrès technique ne va pas de soi :
On imagine souvent que le progrès technologique survient en deux temps : une découverte héroïque et puis une grande transformation économique. Ainsi, quand John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley ont inventé le transistor, cela fut suffisant pour que nous suivions la fameuse Loi de Moore et descendions la courbe des coûts tel un skieur sur une piste noire. La révolution informatique en découle... Mais la Loi de Moore -- selon laquelle la puissance des microprocesseurs double tous les 18 mois --, masque l’énorme quantité d’efforts prodigués par les hommes pour produire de meilleures puces ; elle nous empêche de voir que la rapidité des progrès varie en fonction de la quantité d’efforts consentis.
L’autre face de l’imagerie traditionnelle de la découverte héroïque tient au caractère nécessaire des grandes découvertes. Mais Robert Fogel, un éminent historien, a montré que si le chemin de fer n’avait pas vu le jour au 19ème siècle, les américains auraient investi massivement dans le creusement de canaux, la construction de routes, etc. Au bout du compte, le rythme de croissance économique n’aurait pas été très différent. En fait, il y a bien plus de voies de la découverte qu’on ne l’imagine. (...)
Par suite, les prouesses technologiques comme le chemin de fer ou le transistor ne constituent pas la cause de la croissance. Nos vies sont devenues meilleures parce que quelque chose a poussé des hommes à chercher des moyens qui l’ont rendue meilleure. Et ce quelque chose, c’est le marché et les incitations spéciales qu’il crée.
Toutes les opportunités existantes dans la nature demeureraient inexploitées si l’on n’avait trouvé un moyen de motiver et de coordonner les efforts des hommes. Bardeen, Brattain et Shockley n’ont pas cherché à rendre la vie des hommes plus plaisante. Ce qu’ils voulaient, c’étaient obtenir pour leur compte, et celui de leur compagnie, un profit. Ce faisant, eux et des milliers d’autres ont contribué à améliorer la qualité de ma vie.
La clef de l’histoire des microprocesseurs ne se trouve donc pas du côté de la Loi de Moore, ni dans les dons uniques de certains inventeurs. La clef, c’est que les hommes ont créé le système du marché qui, avec des institutions hybrides comme les Universités et les laboratoires de recherche, a permis de convertir l’intérêt privé en une puissante force capable d’améliorer la vie de tous. Cette invention humaine est beaucoup plus importante que le transistor ou la machine à vapeur, car elle nous a donné ces inventions là et toutes les autres aussi...
Paul ROMER, "Incentives and Innovation" - Outlook, Sept 1998 (trad. par moi).
De là découle le rôle principal du bon Gouvernement : pour maintenir l'économie nationale sur le sentier de croissance, l’Etat doit d’abord veiller à ne pas entraver le processus de destruction créatrice…
Le risque et le gain
x
Paul Romer commence son allocution par cette petite blague :
Un samedi, un docteur, un pasteur, et un économiste patientaient sur le parcours de golf. Juste devant eux, un groupe s'évertuait : ils étaient si maladroits que leurs balles se perdaient, partaient dans toutes les directions, et ils avaient un mal fou à les retrouver. Dégoûtés, las d’attendre, nos trois amis s’en retournent au clubhouse, non sans laisser tomber quelques commentaires peu flatteurs à l’adresse des importuns : le docteur suggéra qu'ils commencent par prendre des leçons, le pasteur proposa que, la prochaine fois, ils réservent en semaine, et l’économiste observa qu’il faut être sans vergogne pour se présenter sur un parcours en jouant si mal... Au clubhouse, ils avisent le directeur et lui font vertement part de leur mécontentement. Et le directeur répondit : « mais n’avez-vous pas vu les panneaux ? Aujourd’hui est un jour réservé aux athlètes handicapés... Ces gens devant vous étaient aveugles ! » A ces mots, le pasteur fut submergé par la honte et promit au directeur de donner un peu de son temps pour accompagner ces personnes sur le parcours ; le docteur, qui regrettait lui-aussi ses propos, promit de donner 5 000 $ pour cette bonne cause. Tous se tournèrent alors vers l’économiste. Après un silence, ce dernier observa : « Ne serait-il pas plus efficient de faire jouer ces gens la nuit ? »
Comme vous savez, l’économie est la science des choix : accepter quelque chose de mauvais pour obtenir quelque chose de bon. Une "histoire de dilemme" comme disait l’un de mes étudiants ("that tradeoff thing..."). Disserter sur le conflit risque/rendement est une manière fructueuse d’évoquer quelques uns des choix les plus importants auxquels chacun de vous devra faire face tout au long de sa vie. Cela rappellera qu’on ne peut obtenir des gains élevés sans prendre quelques risques.
Ce n’est que dans les années 50, à propos des marchés d’actions, que les économistes ont commencé véritablement à s’intéresser à cette question. Jusque là, si incroyable que cela puisse paraître, les analyses des marchés financiers ne mentionnaient pas cette observation fondamentale : à savoir qu’en moyenne, on ne peut espérer un rendement plus élevé qu’au prix d’un risque plus élevé. Vous pouvez placer vos économies en sicav monétaires ou en certificats de dépôts, mais si vous achetez des obligations, qui vous exposent à un risque plus important, vous pouvez espérer un meilleur rendement, et si vous investissez en actions, vous pouvez espérer gagner encore plus ; en ce cas, vous risquez de perdre de l’argent certaines années, ou sur certains titres, il n’y a pas de garantie - c’est en cela que consiste le risque, il n’y a aucune garantie. Néanmoins, si l’on se réfère à l’expérience historique, les économistes vous assurent que l’investissement action rapporte en moyenne et sur longue période plus que toutes les formes de placements moins risquées : en somme, le risque paie.
Cet exemple saisit l’essence de la perspective économique sur le risque. Le risque est un aspect inévitable de l’existence. On vit avec. Autant que possible, on fait avec. Par dessus tout, on l’exploite. Le risque, c’est l’autre face des opportunités.
Maintenant, je voudrais confronter au regard économique, la perspective journalistique sur le risque. C’est ici que ma blague autour du cours de golf entre en scène. La réaction de l’économiste est en effet exemplaire. A mon point de vue, la mission fondamentale de qui enseigne l’économie, c’est de développer chez les étudiants cette aptitude à se défier des émotions et à s’en remettre à la raison.
Or, autant la perspective économiste sur le risque est affaire de raison, autant la perspective journalistique est affaire d’émotions. On voudrait nous faire croire qu’il faut craindre le risque, que nous devons nous en préserver ; qu’en cas d’infortune, il est légitime d’exiger des autres une réparation, que c’est là une affaire de justice, de solidarité. Et quel est le risque qui préoccupe aujourd’hui les médias ? Le genre de risque que vous, étudiants, rencontrerez bientôt pour la première fois de votre vie : le risque de perdre son emploi.
x
Comme à leur habitude, pour nous conter leur version de l’histoire, les médias s’en remettent à l’éternelle fable des bons et des méchants. Pendant la campagne électorale, les étrangers et les immigrants ont tenu le rôle des méchants. Désormais, ce sont les managers, surpayés et engagés dans des politiques de « downsizing ». Qu’importe si, dans les faits, l’ancienneté moyenne dans l’emploi des travailleurs américains n’a pas changé depuis dix ans.
L’approche des médias sur cette question s’inscrit dans le grand registre des peurs collectives. Quelque chose dans notre économie serait en train de basculer, menaçant de précipiter nos enfants dans un avenir sinistre. Ce créneau a toujours été exploité par les médias. De même que les adolescents se délectent de films d’épouvante, de même leurs parents se passionnent pour les récits annonçant « la fin du travail », la mort du capitalisme, et plus généralement l’agonie prochaine de la civilisation occidentale.
Au fil du temps, la menace change de visage, mais le pessimisme demeure. La mode fut un temps aux « limites de la croissance » : la raréfaction des ressources naturelles annoncerait la fin de la croissance. Malthus prophétisait déjà sur le sujet il y a deux cent ans. Aujourd’hui, nous aurions au contraire trop de croissance ; le changement technologique serait trop rapide et compromettrait l’emploi et le niveau de vie du plus grand nombre ; une fracture sociale se développerait entre les « haves » et les « have nots ». Cela aussi est une vieille lune : qu’on pense aux Luddites qui s’opposaient à l’introduction des machines dans les fabriques...
x
Pourtant, une analyse dépassionnée, raisonnée, suggère que le changement et ses perturbations sont consubstantiels au processus de croissance économique. Changement et croissance ont partie liée comme le risque et le gain sur les marchés d’actions. Car il n’est tout simplement pas possible de créer plus de richesses en se contentant de reproduire les façons de faire d'autrefois.
x
Nous n’aurions pu au 20ème siècle augmenter autant notre niveau de vie avec les techniques et les recettes de jadis. L’extension de l’ancien mode de production aurait tôt ou tard épuisé le stock des ressources utiles, et les dommages collatéraux (eg, la pollution) seraient peu à peu devenus insupportables. Pour le coup, les Cassandre qui pointaient du doigt les limites de la croissance auraient eu raison.
Une croissance durable suppose la mise en œuvre de nouvelles façons d’exploiter des ressources rares. Il fut un temps où l’on ne savait utiliser l’oxyde de fer que comme pigment dans l’art rupestre (comme dans les grottes de Lascaux). Plus tard, le silicium ne servait qu’à la fabrication du verre. Aujourd’hui, nous utilisons l’oxyde de fer pour stocker des données dans les disques durs de nos ordinateurs et le silicium pour fabriquer des composants électroniques. Et il existe une infinité de découvertes de ce type, d’opportunités technologiques, à exploiter. Du fait de ce processus incessant de découverte, la croissance est virtuellement sans limites.
Mais nous ne tirerons avantage de ces innovations que si nous acceptons de changer nos modes de vie et nos façons de travailler. De tels changements peuvent être très perturbants. Certains travailleurs voient leurs compétences dévaluées, d’autres doivent changer d’emplois, voire de carrières. On demande assez peu de peintres rupestres et de souffleurs de verre de nos jours, mais la demande est forte en ce qui concerne les artistes graphistes ou les techniciens dans l’industrie des semi-conducteurs.
Certes, nous pourrions conjurer tout risque en écoutant les néo-Luddites. Nous pourrions fermer nos frontières, arrêter la course à la productivité, aux fins de préserver les emplois actuels. Mais le prix que nous devrions payer serait considérable : nous devrions en effet renoncer à la croissance.
Or, la croissance ne permet pas seulement l’augmentation du niveau de vie, elle contribue aussi à mettre en valeur le meilleur de la nature humaine. Dans un monde sans croissance, comme dans un jeu à somme nulle, une personne ne peut gagner que ce qu’elle prend aux autres. Pensez-y. Dans un monde sans croissance, le seul moyen pour vous d’offrir à vos enfants une vie meilleure sera de forcer les enfants des autres à une vie moins bonne. Notre histoire est jalonnée de ce type de spoliations, petites ou grandes. Mais dans un monde en croissance, il n’est plus illogique d’espérer un avenir meilleur pour nos enfants et aussi pour tous les enfants du monde. La croissance économique autorise tout à la fois l’ambition pour les siens et la générosité envers les autres.
Aussi, souhaitons que l’hystérie actuelle des médias autour du thème de l’insécurité économique passe de mode. Si nous pouvons préserver un climat économique et social qui tolère le risque et le changement, vous continuerez de vivre dans une économie qui assure une augmentation continue du niveau de vie. Si vous avez des enfants, vous les verrez bénéficier d’avantages matériels et tirer profit d’opportunités que vous ne pourriez pas même imaginer aujourd’hui. Mais chacun de vous sera exposé au risque de perdre son job. Et ceux d’entre vous qui travailleront dans les secteurs les plus dynamiques de l’économie seront plus exposés que les autres ; en contrepartie, ils gagneront davantage. Vous voyez, c’est encore « that trade-off thing ».
Risk and Return par Paul Romer (traduction personnelle) - Discours de remise des diplômes, Albertson College, juin 1996
x
Mais l’Etat a aussi un rôle plus positif. Pour que le progrès technique suive son cours, l'Etat doit s’efforcer de créer les conditions institutionnelles favorables à l'innovation en protégeant les brevets (grâce auxquels l’innovateur percevra les fruits de son innovation) ou en développant le capital risque ; il doit aussi investir dans la connaissance, en particulier dans la recherche et dans l’éducation supérieure. C'est bien là tout le problème français (*).
x
x
NB: Sur ce sujet, on consultera avec profit les articles en ligne de Paul Romer, les synthèses et conférences érudites de Joel Mokyr (historien économiste grand spécialiste de l'histoire de l'innovation), The Conquest of nature, un grand livre sur la révolution industrielle de Gregory Clark et The Handbook of Economic Growth édité par Philippe Aghion. Enfin, le site d' Angus Maddison comprend des liens vers ses principales publications et les données qu'il a patiemment recueillies sur l'histoire de la croissance économique.

 Insee, indicateurs annuels
Insee, indicateurs annuels d'après Xavier Timbeau, Le partage de la valeur ajoutée en France, Rev. de l'OFCE janv. 2002, complété avec les indicateurs annuels de l'Insee 2005
d'après Xavier Timbeau, Le partage de la valeur ajoutée en France, Rev. de l'OFCE janv. 2002, complété avec les indicateurs annuels de l'Insee 2005



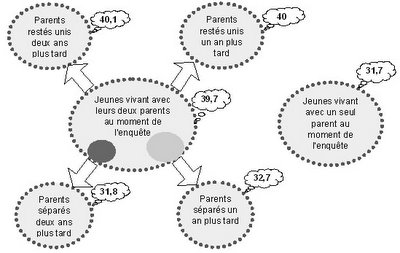
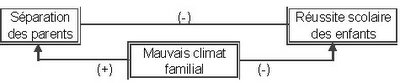


 ... Toujours tirer vers soi.
... Toujours tirer vers soi.








